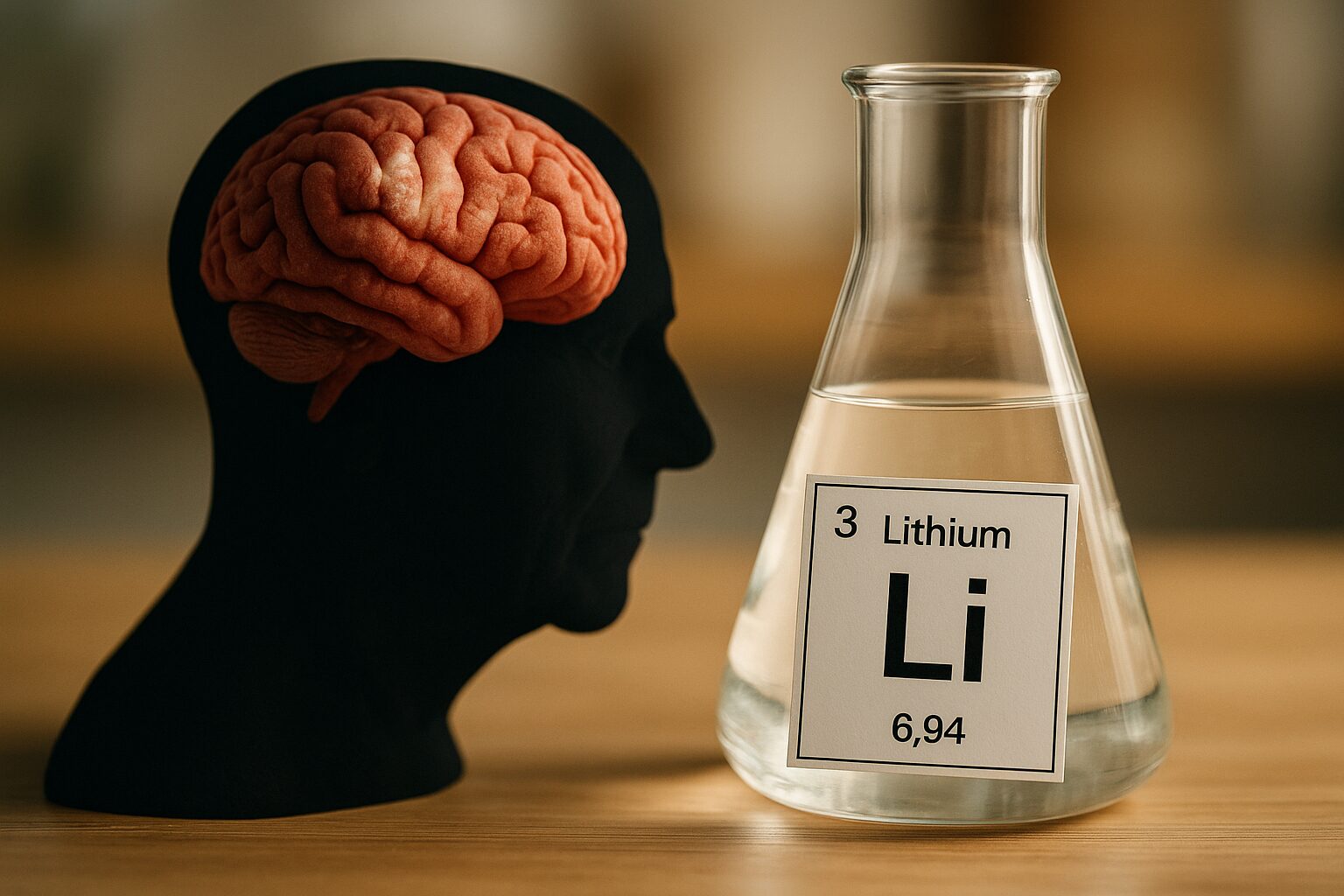Somaire
Contexte scientifique et actualité
Depuis plusieurs décennies, la recherche sur la maladie d’Alzheimer (MA) se concentre sur l’élimination des plaques amyloïdes et la réduction des enchevêtrements neurofibrillaires de protéine tau. Pourtant, malgré des milliards investis et des centaines d’essais cliniques, peu de traitements se sont montrés réellement efficaces. En août 2025, une étude coordonnée par l’équipe de Bruce Yankner (Harvard Medical School) et publiée dans Nature a ouvert une piste inédite : le rôle du lithium, un oligo-élément jusqu’ici surtout connu pour son usage en psychiatrie, pourrait être central dans la physiopathologie d’Alzheimer.
Cette découverte repose sur un constat : parmi 27 métaux mesurés dans des tissus cérébraux humains, le lithium est le seul dont la concentration diminue significativement dès les stades précoces de déclin cognitif, bien avant les manifestations cliniques sévères. Plus surprenant encore, cette diminution semble aggravée par un phénomène de séquestration dans les plaques amyloïdes, réduisant la fraction biologiquement active disponible pour les neurones.
L’étude Nature/Harvard 2025 : méthodes et résultats
L’équipe a analysé des échantillons post-mortem de cortex préfrontal provenant de trois groupes : sujets cognitivement normaux, patients présentant un trouble cognitif léger (MCI) et patients Alzheimer avérés. Les mesures élémentaires ont révélé une chute nette du lithium dès le stade MCI, sans modification notable dans d’autres régions comme le cervelet, ce qui plaide pour un processus ciblé et non une perte globale.
Pour comprendre la causalité, les chercheurs ont utilisé des modèles murins génétiquement programmés pour développer des lésions amyloïdes et tau. Les souris soumises à un régime appauvri en lithium (~50 % de réduction) ont développé l’ensemble du tableau Alzheimer-like : accumulation d’amyloïde-β, hyperphosphorylation de tau, activation microgliale pro-inflammatoire, perte synaptique et démyélinisation. À l’inverse, l’administration de lithium orotate à faible dose a inversé ces altérations, même chez des animaux âgés symptomatiques.
Mécanismes biologiques proposés
Plusieurs mécanismes convergents ont été identifiés :
- Séquestration amyloïde : le lithium se lie aux dépôts amyloïdes, le rendant indisponible pour ses fonctions neuroprotectrices.
- Activation de GSK-3β en cas de déficit : cette kinase favorise la phosphorylation pathologique de tau et l’agrégation amyloïde.
- Dysfonction microgliale : la carence en lithium perturbe le système immunitaire cérébral, réduisant la capacité de clearance des débris neuronaux.
- Démyélinisation : le lithium soutient la survie et la fonction des oligodendrocytes ; sa baisse fragilise la conduction nerveuse.
- Altérations transcriptomiques : les profils d’expression génique observés en déficit lithiumique chez la souris miment ceux des cerveaux Alzheimer humains.
Le lithium comme biomarqueur précoce
Le fait que la baisse de lithium soit détectable avant les lésions irréversibles ouvre la voie à son utilisation comme biomarqueur prédictif. En théorie, une mesure non invasive (sanguine ou via imagerie cérébrale spécialisée) pourrait permettre d’identifier les individus à risque bien avant l’apparition des symptômes. Toutefois, aucune technique validée en routine n’existe à ce jour.
Apports alimentaires et sources naturelles
Le lithium est présent à l’état de traces dans de nombreux aliments et dans l’eau. Les sources les plus notables incluent :
- Légumineuses : pois, haricots, lentilles, pois chiches.
- Légumes : pommes de terre, tomates, choux.
- Céréales complètes : blé, orge, riz complet.
- Noix et graines : noisettes, graines de tournesol, amandes (teneurs modestes).
- Produits de la mer : certaines espèces marines en contiennent, selon la zone de pêche.
- Eaux minérales : teneurs variant de quelques µg/L à > 1 mg/L selon la source.
Les apports quotidiens via l’alimentation sont très variables géographiquement. Il n’existe pas d’AJR officielle, mais certaines publications évoquent un repère exploratoire autour de 1 mg/j chez l’adulte. Pour un panorama détaillé et des ordres de grandeur par aliment ou eau, voir notre article : Aliments riches en lithium : ce que l’on sait.

Perspectives thérapeutiques : le cas du lithium orotate
L’orotate de lithium se distingue des formes classiques (carbonate) par sa moindre affinité pour les dépôts amyloïdes et sa capacité à maintenir une biodisponibilité cérébrale efficace. Dans l’étude Nature 2025, son administration à faible dose a permis une réversion des marqueurs pathologiques chez la souris, sans effets indésirables observés. Cela en fait un candidat sérieux pour des essais cliniques précoces.
Enjeux et perspectives de recherche
Les prochains défis pour la communauté scientifique sont multiples :
- Conduire des essais randomisés contrôlés chez l’humain pour évaluer l’efficacité et la sécurité du lithium orotate dans la MA.
- Développer des méthodes fiables de mesure du lithium cérébral chez le vivant.
- Explorer la fenêtre thérapeutique optimale (prévention vs traitement des stades précoces).
- Évaluer l’impact d’apports alimentaires augmentés en lithium sur les biomarqueurs cognitifs.
Précautions et limites
Malgré l’enthousiasme, plusieurs points appellent à la prudence :
- Les résultats positifs proviennent essentiellement de modèles animaux ; ils ne garantissent pas une transposition à l’humain.
- Le lithium médicamenteux a une marge thérapeutique étroite et peut provoquer des effets indésirables graves (atteintes rénales, thyroïdiennes, neurologiques).
- Une auto-supplémentation est déconseillée hors cadre médical.
Sources et lectures complémentaires
- Aron L. et al., 2025. Lithium deficiency and the onset of Alzheimer’s disease. Nature.
- Harvard Medical School. « Could Lithium Explain — and Treat — Alzheimer’s Disease? », 2025.
- JAMA Psychiatry, 2017. « Association of Lithium in Drinking Water With the Incidence of Dementia ».
- Revues PMC (2018, 2024) sur les teneurs alimentaires en lithium.
Cet article est informatif et ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé.